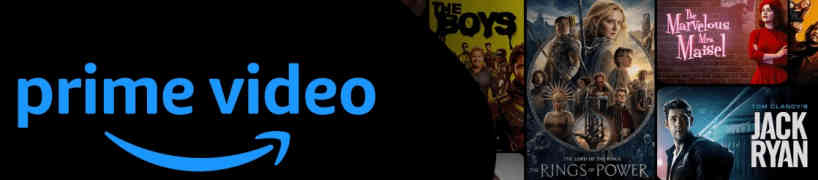Nicolas POUSSIN
Nicolas POUSSIN, peintre français, né dans la commune des Andelys (Eure) en 1594 et mort à Rome en 1665.BIOGRAPHIE.
D'abord élève de Quentin Varin, il vint à Paris, où il entra dans l'atelier du Flamand Ferdinand Elle, puis dans celui de Lallemand. Deux fois, il essaya de s'acheminer vers Rome; la maladie l'arrêta deux fois en route. C'est seulement en 1624, qu'il parvint en Italie. L'Algarde et le sculpteur Duquesnoy l'associèrent à leurs études. Il défendit le Dominiquin âgé, devint l'hôte du Français Jacques Dughet dont il épousa la fille Anna-Maria en 1629, et s'établit sur le Pincio. Il peignit pour son protecteur, le cardinal Barberini, la Mort de Germanicus et la Prise de Jérusalem (Louvre), et pour le cardinal Omadei, l'Enlèvement des Sabines. Son goût attique parut enfin dans tout son éclat dans la première série des Sept sacrements, exécutés pour le commandeur Cassiano del Pozzo.
La France, cependant, commençait à s'occuper de Poussin. Le peintre Jacques Stella, s'étant rendu à Paris en 1637, parla de lui avec éloge à Chantelou, maitre d'hôtel du roi. Celui-ci lui fit la commande d'un tableau, la Manne (Louvre), que l'artiste exécuta après deux autres oeuvres : Camille renvoyant les enfants des Falisques (Louvre), pour La Vrillière, secrétaire d'Etat, et le Frappement du rocher, pour Gillier. Stella lui commanda le tableau Armide et Renaud. Le secrétaire d'Etat des Noyers lui envoya, d'après l'ordre de Richelieu, une invitation directe, accompagnée d'une lettre du roi. Poussin adressa au cardinal quatre de ses Bacchanales (le Louvre en possède deux) et Saint Jean baptisant le peuple. De Chantelou alla le chercher à Rome, et le força de se rendre avec lui à Paris (1640). Il fut logé au Louvre ; Louis XIII le reçut à Saint-Germain.
Le premier ouvrage que Poussin exécuta après son retour fut un grand tableau commandé par Louis XIII, la Cène, pour l'église de Saint-Germain. Poussin peignit ensuite la Vérité que le Temps enlève et soustrait aux atteintes de l'Envie et de la Calomnie (Louvre). Toutefois il retourna à Rome dès l'année suivante, à cause des jalousies dont il était l'objet. Parmi les oeuvres qui suivirent, citons : le Ravissement de saint Paul (1643) ; en 1644, le peintre commença à travailler à la seconde série des Sept sacrements, qu'on a longtemps admirée au Palais-Royal.
Dans les quatre tableaux la Mort de Saphire, la Femme adultère, les Aveugles de Jéricho, et Rébecca, Poussin voulut donner, par l'opposition et la gradation des expressions, un exemple des quatre modes qu'il s'attachait surtout à suivre : le riant, le touchant, le grave, et le terrible. Les deux tableaux Obsèques et Cendres de Phocion, sont à la fois paysages et tableaux d'histoire. En même temps, il se livrait à sa féconde imagination dans la disposition des sujets mythologiques ou fantaisistes : Polyphème appelant Galatée au son de sa flûte; Diogène jetant son écuelle en voyant un jeune homme boire dans le creux de sa main; Scène d'effroi; Pyrame et Thisbé; Orphée; les Bergers d'Arcadie. Le Déluge fut son dernier tableau. Ces quatre toiles sont au Louvre.
Poussin est le maitre de la peinture classique : élève des anciens, admirateur de Raphaël et de Jules Romain, il excella dans une beauté simple, un peu sèche au début de sa carrière, qui devint par la suite plus riche et plus moelleuse, mais à laquelle n'ont jamais manqué ni la grâce des contours, ni la force de l'expression. Poussin a laissé de lui-même un excellent portrait, aujourd'hui au Louvre.
Œuvres d'inspiration mythologique :
Œuvres d'inspiration biblique :
Œuvres d'inspiration historique :
Œuvres d'inspiration littéraire :
❖ Recherches :
© Images are copyright of their respective owners, assignees or others